Projets de recherche Lauréats - Université Bordeaux Montaigne
Projets de recherche Lauréats

L'université Bordeaux Montaigne, de par le dynamisme de ses unités de recherche, s'investit auprès des acteurs socio-économiques publics et privés pour inventer avec eux des solutions de demain. Elle est partie prenante de ce puissant mouvement des sciences humaines et sociales qui aide à comprendre le monde et à agir sur les évolutions des sociétés humaines. Pour ce faire elle soutient de nombreux projets de recherche par l'intermédiaire de son appel à projets interne qui stimule cette dynamique et propulse les projets auprès de la société avec le soutien et l'aide des financeurs publics de la recherche mais aussi privés. Mais l'université intégrée à son environnement n'agit pas seule. La recherche à l'université Bordeaux Montaigne est soutenue par de nombreux partenaires soit en collaborant aux recherches réalisées soit en initiant des thèmes de recherche soit en finançant des projets ou actions, soit en promouvant ou diffusant sa recherche en sachant que les soutiens ne sont pas exclusifs. Ainsi sont présentés ici à titre d'exemple, un panels de projets de recherche, non exhaustifs de sa riche activité, lauréats des appels à projets de partenaires fortement ancrés dans le paysage européen, national et régional du financement de la recherche.
L'Université Bordeaux Montaigne vous propose, à titre d'exemple, un panel de projets non exhaustif de sa riche activité.
- Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine
- Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
- Projets financés par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
- Lauréats 2021 de l'institut universitaire de France Junior
Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine

AgroPast
AgroPast est un projet de recherche interdisciplinaire d’histoire et d’archéologie médiévales consacré à l’étude du système agropastoral des Landes de Gascogne durant le Moyen Âge et sur le temps long.
Porteur : Frédéric Boutoulle, AUSONIUS
Durée : 36 mois (2021-2024)
Budget total : 122 000 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80 % + un financement de thèse (50% région Nouvelle-Aquitaine et 50% Université Bordeaux Montaigne).
Projet en partenariat avec : ITEM (UPPA), Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, écomusée de Marquèze (40), la société Biolandes, et la SCOP d'archéologie préventive Hadès.ALGO-J exploration du rôle des algorithmes dans le secteur de l’information
Le projet Algo-J est consacré à l'étude de la place et du rôle des algorithmes numériques dans le secteur de la presse à l'échelle régionale. Le projet comprend un enjeu social évident consistant à mettre en lumière l'incidence des algorithmes sur les journalistes et leurs publics.
Porteuse : Rayya Roumanos, MICA
Durée : 24 mois (2021-2023)
Budget total : 25 000 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : le journal Sud Ouest, l'association NACSTI, Cap Sciences, le club de la presse de Bordeaux, l'Association des journalistes diplômés de l'IUT/IJBA, le CLEMI et Reporters Sans frontières.Villes et systèmes alimentaires durables (VISA) : marché urbain, maraîchage agroécologie et labels au Cameroun
Les objectifs du projet de recherche-action interdisciplinaire sont d’analyser la place et le fonctionnement de la filière maraîchère dans le système alimentaire du territoire métropolitain de Douala, ainsi que les impacts et les perspectives métropolitaines d’une démarche qualité pour la filière « maraîchage agroécologique ».
Porteur : Sylvain Racaud, LAM
Durée : 36 mois (2021-2024)
Budget total : 184 000 € de fonctionnement + un financement de thèse (50% région Nouvelle-Aquitaine et 50% Université Bordeaux Montaigne). Le CRNA finance à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : AANA, INTERCO (agence de coopération international Nouvelle-Aquitaine), Bordeaux métropole, Let’s Food Cities, FAO (Food and Agriculture Organisation), RURALITES (Université de Poitiers), Communauté Urbaine de Douala, GAD (Groupement d'Appui pour le Développement Durable du Cameroun), GRET, Université et commune de Dschang au Cameroun.ICI Intermédialité Créative et Inclusive
Le projet Intermédialité Créative et Inclusive (ICI) porte sur les relations entre littérature et médias. Il s'inscrit dans le tournant médiatique de la littérature et de la recherche-création dans les études littéraires. Le but du projet est de constituer à terme un centre européen de l'intermédialité créative et inclusive (CEICI) en région Nouvelle Aquitaine pour valoriser les compétences locales, fédérer les actions déjà en œuvre et être identifié comme un pôle d'expertise et de création.
Porteuse : Magali Nachtergael, Plurielles
Durée : 36 mois (2021-2024)
Budget total : 66 000 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : EHIC (Université de Limoges), FoReLLIS (Université de Poitiers) et Sciences Po Bordeaux, le Frac Méca Nouvelle Aquitaine, les Francophonies, des écritures à la scène et Bruits de langue.MediaBD 2
Le projet MEDIABD 2 vise à produire des connaissances spécifiques sur la réception et l’histoire de la bande dessinée, une filière particulièrement bien implantée en Nouvelle Aquitaine. Il entend simultanément contribuer à la compréhension des transformations des industries culturelles à l’ère du numérique, au travers notamment des questions d’indexation et de valorisation du patrimoine. Le cœur du projet est la base de données MEDIABD hébergée à la Cité de la Bande Dessinée d'Angoulême.
Porteur : Nicolas Labarre, CLIMAS
Durée : 36 mois (2021-2024)
Budget total : 117 500 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80% + 92 000 € d'allocation post doctorat à La Rochelle Université.
Projet en partenariat avec : LACES (université de Bordeaux), L3i (université de la Rochelle), CREM (université de Lorraine) et la cité de la bande dessinée d’Angoulême et son école des métiers du cinéma et de l’animation.Aquitania ornata, Formes, matériaux et techniques du décor pariétal en Aquitaine romaine
Aquitania ornata a pour ambition de structurer un réseau interdisciplinaire de chercheurs travaillant sur le décor pariétal de l’Aquitaine romaine. L’objectif est de contribuer à une synthèse d’ampleur sur les décors pariétaux de la province d’Aquitaine, en faisant une place de choix à la question des matériaux et des techniques, tout en œuvrant au développement d’approches archéométriques innovantes ou en pleine expansion. Il s’agira également de mettre en évidence ce que la connaissance de ces techniques peut apporter aux réflexions actuelles autour d’un bâti plus durable.
Porteuse partenaire : Isabelle Pianet, Archéosciences Bordeaux
Durée : 36 mois (2021-2024)
Budget total : 59 580 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80% + un financement de thèse à l’université de Poitiers.
Projet en partenariat avec : l'université de Poitiers (coordinateur), DRAC Poitiers, le musée Sainte-Croix (Poitiers), le musée d’Aquitaine, le site archéologique de Chassenon, le musée de la ville de Saintes, Eveha, Erea, Espace Mendes France.Memoria in aeternum ? Le recyclage des pierres tombales romaines dans le bâti aquitain dès l'Antiquité
Que reste-t-il aujourd'hui des pierres tombales qui meublaient en grand nombre les cimetières aquitains du Haut-Empire romain (1-300 p.C.), époque où a fleuri la pratique épigraphique ? Nombre d'entre elles se retrouvent encore aujourd'hui remployées sur des bâtiments publics et privés. Le programme est donc d'abord une démarche patrimoniale visant à inventorier et à protéger ces restes des archives de la population de l'Aquitaine venues de la lointaine Antiquité.
Porteur : Milagros Navarro Caballero, AUSONIUS
Budget total : 81 400 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : le GRD ReMarch (CNRS), AnHiMA (CRNS/EHESS) (Université de Poitiers), consortium VALETEVIATORES, Fédération Aquitania.Cov'Culture - Impact de la crise sanitaire sur le domaine de la culture et de l’art en Nouvelle Aquitaine
Ce projet de recherche vise à observer et analyser l’impact de la pandémie et ses conséquences sur les activités culturelles et artistiques pour les personnes qui travaillent dans ce domaine, celles qui s’y impliquent bénévolement, celles qui s’en approprient les contenus. L’objectif est de rendre visible la façon dont les différentes catégories d’acteurs ont œuvré, procédé, afin de permettre un maintien des activités culturelles et artistiques, tant du point de vue de la création, que de la diffusion ou de la réception.
Porteuse : Sarah Montero, PASSAGES
Durée : 36 mois (2021-2024)
Budget total : 70 000 € de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80 %.
Projet en partenariat avec : la DRAC NA, la MSHA et Agence Régionale l'A, Opale-Ufisc, Association Danse et ville, le Fabricc (Université de Poitiers), médiathèque de Biarritz, Avant scène de Cognac et les araignées philosophes de Bordeaux.Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Programme partenariats avec l’enseignement supérieur africain
MadAtlas : cartographie numérique au service du développement durable de Madagascar
MadAtlas propose un parcours LMD axé sur l’information cartographique numérique au service du développement durable des territoires à Madagascar. Il combine géographie, géomatique et informatique, et conduit à la recherche ou à la professionnalisation en impliquant les acteurs publics et privés de l’aménagement du territoire et des technologies de l’information et de la communication.
Vers une université d’été de la géomatique.
Coordinateur : Université Gustave Eiffel
Porteurs : Xavier Amelot, PASSAGES
Durée : 48 mois (2021-2025)
Budget total : 2 780 000€
Projet en partenariat avec : IRD, Université de Fianarantsoa (Madagascar).AAPG 2021-projet de recherche collaborative
GEOPRAS : Géoarchéologie et préhistoire des sociétés atlantiques
Le programme GEOPRAS étudie les sociétés littorales de la Préhistoire récente (Mésolithique et Néolithique) de la façade atlantique française, afin de comprendre leur organisation sociale et économique et leur rôle dans des dynamiques historiques telle que la néolithisation. L'accumulation de biens par le stockage, la spécialisation des modes de production, l'émergence de hiérarchie sociale ou d'un mode de vie sédentaire sont souvent attribués à ces populations côtières, sur la base de documents ethnographiques des deux derniers siècles.
Coordinateur : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAHH, Rennes).
Porteuse, partenaire : ,Florence Verdin (florence.verdin @ u-bordeaux-montaigne.fr), AUSONIUS
Durée : 48 mois (2022-2025)
Budget total : 490 750,08€ dont part UBM 32 704€
Projet en partenariat avec : CReAAH, LETG, LIENSs, INRAP, ECOBIO, LEMARAAPG 2021- projet de recherche collaborative
The MileStone Age : Late Pleistocene chronology and technologies in southern Africa
The MileStone Age interroge la réalité des différences techniques entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age, questionne les scénarios de transition, et soulève les nœuds épistémologiques qui influencent notre construction des modèles évolutifs. Le projet vise in fine à redéfinir la nature des traditions et des successions techniques en Afrique australe et à clarifier leurs chronologies absolues.
Porteuse : Chantal Tribolo, Archéosciences Bordeaux
Budget total : 192 080€
Projet en partenariat avec : UMR IPREM (CNRS/UPPA), UMR LAMPEA (CNRS/Aix Marseille Université), Université de Cape Town (Afrique du Sud), Université de Tübingen (Allemagne), Traceolab Université de Liège (Belgique).Sciences Avec et Pour la Société SAPS-RA-MCS 2021
FABLAB-MORE : Médiation, Optimisation, Redocumentarisation et enjeux de savoirs
FabLab-More vise à expérimenter et analyser les potentialités de développement du champ d’action des FabLabs à travers l’amélioration de la documentation, de la communication et les processus d’intermédiation, dans des logiques d’ouverture sociale plus que d’innovation technologique experte autour d’espaces participatifs de diffusion des savoirs. Mise en pratique à travers des expérimentations auprès du jeune public dans un réseau de FabLab local et international.
Coordinateur : UBM
Porteur : Vincent Liquète, MICA
Durée : 24 mois (2021-2023)
Budget total : 76 160 €
Projet en partenariat avec : Cap Sciences, le Ségou FabLab (Mali), l’ESSTIC de Yaoundé (Cameroun), le laboratoire IMS de l’université de Bordeaux.Projets financés par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

CO//ECTIF
PIAIA : Pratique informationnelles des acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique
Ce projet vise, d'une part, à explorer les pratiques informationnelles des acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique et, d’autre part, à comprendre les stratégies de veille d’informations, mais aussi de dissémination mises en place sur le terrain par les acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique. Au-delà d'un simple listage, il s'agira de voir l'écart existant entre besoin et offre d'information disponible ou mobilisée et de concevoir une plateforme susceptible de répondre aux besoins des acteurs.
Le projet est mené par des chercheurs issus de onze institutions.
Porteur : Alain Kiyindou, MICA
Durée : 14 mois
Budget total : 22 020€ dont 15 000 € de subvention AUF.Houdoud/Frontières : La fertilisation des savoirs à l’université par la rencontre entre l’art et la recherche : pour une meilleure inclusivité citoyenne
Allier l’art et la recherche comme une invitation au dialogue et à la création, et à l’échange citoyen, pour dépasser les frontières imaginaires, disciplinaires, voilà l’objectif ambitieux de Houdoud/Frontières. En invitant des artistes et des chercheurs à dialoguer, travailler et réfléchir entre eux et avec les sociétés civiles sur des enjeux contemporains, le projet a pour ambition de renouveler les savoirs et les discours sur les réalités de nos sociétés actuelles, de défendre des regards singuliers, portés par des artistes, pour nous amener à réfléchir à la question complexe des identités, multiples et en mouvement, comme un pied de nez aux visions figées, cloisonnées et rétrogrades des savoirs et du monde.
Porteur : Omar Fertat, Plurielles
Durée : 18 mois
Budget total : 52 000 € dont 25 000 € de subvention AUF.Lauréats 2021 de l'institut universitaire de France Junior

- Vivianne Albenga, maître de conférences en métiers du livre, MICA
- Nicolas Patin, maître de conférences en histoire moderne, CEMMC
- Françoise Poulet, maître de conférences en langue et littérature du XVIIe siècle, PLURIELLES
- Michael Stambolis, maître de conférences en anglais, CLIMAS
- Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine
- Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
- Autres projets financés
- Lauréats 2022 de l'institut universitaire de France
Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine

Chaire diasporas africaines et transculturalité
La chaire diasporas africaines et transculturalité de l’université Bordeaux Montaigne est lauréate en 2023 de la Chaire d’excellence régionale pour l’Emergence, la Science et la Société (CHESS) de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est portée par le laboratoire Les Afriques dans le Monde (UMR CNRS, Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux Montaigne et IRD).
La Chaire vise à renouveler les travaux scientifiques relatifs aux diasporas africaines en étudiant notamment avec plus de précision leurs rapports avec la création littéraire et artistique, les médias traditionnels et les nouveaux médias, ainsi que les champs politique et économique.
Coordination : Sylvère Mbondobari, professeur de littérature, spécialiste des littératures coloniales, francophones et des études interculturelles et diasporiques, LAM ; co-pilotage : Sylvain Racaud, maître de conférences en géographie économique et politique, LAM
Durée : 4 ans (2023-2027)
Budget total : 438 732€ (376 232€ Région NA) dont deux contrats doctoraux, un contrat post-doctoral et un ingénieur projet
Partenaires : MESRI, Région NA, Sciences Po Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, CNRS ; Partenaires de la société civile et socio économique : Institut des Afriques (IdAf) , MC2a, Musée d’Aquitaine, ALCA ; Partenaires internationaux : Omar Bongo (Gabon), Cheikh Anta Diop (Sénégal), Ottawa (Canada), Fordham (USA), Saarlandes-Bayreuth et Humboldt-Berlin (Allemagne)InterClim Interventions conséquentes : les scientifiques face à leur rôle dans les réponses politiques au changement climatique
InterClim est un projet d’expertise scientifique sur le cas du changement climatique, un problème mondial à fort enjeu pour lequel la contribution des experts est constamment sollicitée. Il étudie les scientifiques travaillant sur le changement climatique dans la Région Nouvelle Aquitaine, mais aussi en France, auprès des institutions de l’Union Européenne et celles des Nations Unies. Le projet aura des applications directes pour la politique régionale de lutte contre le changement climatique.
Co-porteurs : Cédric Brun, Michael Stambolis-Ruhstorfer, SPH et CLIMAS
Durée : 36 mois (2023-2025)
Budget total : 78 270 € de fonctionnement financés par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80 %
Projet en partenariat avec : partenaires socio-économiques (la DRÉAL Nouvelle-Aquitaine, association Ecocène), partenaires académiques (SciencesPo Bordeaux, CNRS, Université de Limoges, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Toulouse-Jean Jaurès et le réseau régional de recherche Futurs ACT)SEXTEEN
Ce projet de recherche pluridisciplinaire vise à travailler sur les représentations des sexualités dans les séries télévisées américaines, françaises et anglaises, et sur leur réception par les publics adolescents. Le projet est situé à la rencontre entre la recherche-action et la science participative.
Porteuse : Mélanie Bourdaa, MICA
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 45 800€ de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : la Fondation John Bost (Bergerac), l’association Le Girofard, le Cacis, l’association de la LCD (Bordeaux), le collège innovant Pierre Emmanuel et le lycée Jacques Monot (Lescar) et la Maison des ados, AdoEnia (Bayonne), l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.COJEMI Communication et construction de l’opinion sur les jeunes migrants isolés
Le projet COJEMI vise à analyser comment se construit la fabrique de l'opinion sur les jeunes migrants non accompagnés afin d'éclairer les politiques publiques mais également les prises de position des citoyens. C'est l'objet principal de cette étude, avec trois objectifs complémentaires : l’étude de la couverture médiatique du sujet, l’étude de la réception de ces discours par les acteurs impliqués et par les jeunes migrants eux-mêmes et enfin les discours publics que les acteurs institutionnels et associatifs produisent en réaction.
Porteur : Etienne Damome, MICA
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 96 245€ de fonctionnement financés par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 80 %
Projet en partenariat avec : SciencePo Bordeaux, Université de Poitiers, Université de Montpellier l’UCOPaRL Patrimoine Régional Linguistique entre variation linguistique, représentations sociales et enjeux didactiques
Le projet PaRL se fixe pour objectif de répondre au défi que pose l’évolution de nos sociétés vers un fonctionnement plurilingue où se côtoient dans un même environnement des langues aux statuts très variés. La question du patrimoine linguistique et des langues régionales est une problématique sociétale d’actualité. Le projet PaRL, en participant à la documentation de ces langues et en développant des interactions entre le monde académique et d’autres organismes publics intervenant directement sur les langues en question participera au développement économique et social associé aux langues de la région, à savoir l’occitan, le basque, et le poitevin saintongeais.
Porteur : Nicolas Guilliot, CLEE Montaigne
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 155 035 € dont fonctionnement et un financement de thèse (50% région Nouvelle-Aquitaine et 50% Université Bordeaux Montaigne). Le CRNA finance à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Poitiers et Université Toulouse-Jean Jaurès, la MSH Bordeaux, MSHS et les réseaux de partenaires socioéconomiques (Office Public de la Langue Occitane, Office Public de la Langue Basque, la DRAC et la Délégation générale à la langue française et aux langues de France) et associations de promotion des langues telles que l’Arantèle, écoles associatives Calandreta ou Ikastola)AMEL Aquitaine Multilingual Experimental Lab
Le projet AMEL prévoit la création sur le campus de La Nive de Bayonne d’une plateforme expérimentale consacrée à la recherche sur les questions fondamentales concernant les bases cognitives et cérébrales de l’acquisition du langage dans des contextes plurilingues. la nécessité de fournir une description rigoureuse des stades de développement de l'enfant bilingue/multilingue émerge clairement aujourd’hui afin de pouvoir mettre en relation le développement (a)typique de l’individu plurilingue et le processus de scolarisation, et de guider la communauté des orthophonistes, psychologues et neuropsychologues, qui sont quotidiennement confrontés à des questions de diagnostic et de réadaptation des troubles du langage et qui sont à ce jour privés de toute ressource.
Porteur : Urtzi Etxeberria, IKER
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 330 072 € dont fonctionnement, 1 allocation post doctorale, 2 allocations doctorales. La Région finance à hauteur de 80% pour le fonctionnement, à hauteur de 50% pour les allocations et la communauté d’agglomération du Pays Basque à hauteur de 50% pour les allocations.
Projet en partenariat avec : réseaux de collaborations nationales, transfrontalières et internationales. Université Paris Descartes, Université de Pau et des Pays de l’AdourL’irruption du sauvage en ville. Quand le sanglier et la faune des forêts brouillent les frontières
Le projet propose d’explorer le problème posé par la faune sauvage en ville avec ses ramifications multiples : transformation de l’écologie des espèces, représentations sociales du sauvage, relation urbain-rural, politiques de la nature en ville, effets de la confrontation de l’urbain au sauvage.
Porteur : Laurent Couderchet, CNRS PASSAGES
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 157 468 € dont fonctionnement et 1 allocation post doctorale. La Région finance à hauteur de 80% pour le fonctionnement, à hauteur de 50% pour l’allocation et 50% Bordeaux Métropole.
Projet en partenariat avec : UMR LAM, Université de Limoges (UMR Geolab) et partenaires socio-économiques (Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Fédération Régionale de Chasse de Nouvelle Aquitaine, Fédération Départementale de Chasse de la Dordogne, Fédération Départementale de Chasse de la Gironde)TILTeR : TIers-Lieux : Territoires et Réseaux
Le projet TiLTeR appréhende les tiers-lieux sous deux angles complémentaires : comme objets en interactions réciproques avec les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ils en sont à la fois une forme de représentativité de leurs caractéristiques, mais également facteurs de développement ; comme objets de relations au sein de réseaux spatiaux, et ce à différentes échelles : du micro (au sein même des tiers-lieux, entre ses acteurs) au macro (échanges d’expériences entre tiers-lieux à l’échelle planétaire). Cette double approche permettra d’éclairer les notions de viabilité des tiers-lieux et de savoir s’ils peuvent être considérés comme des outils de durabilité pour les territoires dans lesquels ils sont implantés.
Porteur : Patrice Tissandier, CNRS PASSAGES
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 178 500 € dont fonctionnement et 1 allocation doctorale. La Région finance à hauteur de 80% pour le fonctionnement, à hauteur de 50% pour l’allocation doctorale et 50% ADEME.
Projet en partenariat avec : Centre Emile Durkheim (Science Po Bordeaux) et Labri (UB) et partenaires socio-économiques Coopérative Tiers-Lieux, Conseil Départemental de la Charente-Maritime, Conseil Départemental des Landes, Teritorio, Réseau TELA (Tiers-lieux de la Creuse), Agglomération de Tulle, Ville de Bergerac, Communauté d’agglomération Pays Basque, Communauté de Communes du Grand Cubzaguais, Commune de Plassac (33)Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

AAPG 2022 – CE27 – Études du passé, patrimoines, cultures - Projet de recherche collaborative
SAHYLOR : Salubrité, Alimentation, Hygiène : les latrines d’Ostie, port de Rome
Le projet SAHYLOR consiste en une approche innovante de l’hygiène dans l’Antiquité romaine, au travers du prisme d’une ville portuaire de première importance et port de Rome : Ostie. Profitant des acquis de projets antérieurs menés sur l’île de Délos, cette étude pluridisciplinaire enrichie (associant archéologie du bâti, paléoparasitologie et paléogénétique, palynologie, archéo-ichtyologie, sociologie et informatique), apportera une touche supplémentaire au tableau plus vaste de l’hygiène en méditerranée antique. Ce type d’approche pourra ainsi servir de modèle à des projets ciblés sur d’autres régions, jusque-là peu appréhendées, à l’instar de l’Afrique du Nord, de l’Egypte ou de l’Orient. Ce projet permettra de renouveler la connaissance de l’état sanitaire de la population, de son alimentation comme de son environnement.
Coordinateur : Alain Bouet, AUSONIUS
Durée : 48 mois (2022 – 2026)
Budget total : 454 065 € dont part UBM 246 897 €
Projet en partenariat avec : EPHE, MNHN (ISYEB), Parco archeologico di Ostia antica, École Française de Rome, Université de Rennes, Université Franche-Comté (CHRONO UMR 6249)MEMOAr : MEthode pour la datation des MOrtiers de chaux ARchéologiques : caractérisation, extraction, datation, validation
La chronologie de la construction et des modifications ultérieures est l'une des questions majeures de l'analyse archéologique des monuments, de l'Antiquité au Moyen Âge, où les textes font souvent défaut. Le projet MEMOAr est particulièrement innovant en termes de méthodologie proposée, il permettra une datation plus précise et plus fiable des bâtiments archéologiques. Il aura un double impact. Le premier est archéologique : il propose une méthode nouvelle et efficace de datation absolue. Le second est instrumental : il permettra de développer un instrument innovant capable de caractériser les zones d'intérêt et d'extraire le carbone de zones ciblées dans des matériaux hétérogènes pour la datation.
Coordinateur : Anne SCHMITT, ArAr, Université de Lyon 2
Porteur à l’UBM, partenaire : Christian Gensbeitel, Archéosciences Bordeaux
Durée : 48 mois (2022 – 2025)
Budget total : 523 393 € dont part UBM 75 500 €
Projet en partenariat avec : université de Lyon 1 et 2 et l’IRPA (Brussels)AAPG 2022 – CE55 – Sociétés et territoires en transition - Projet de recherche collaborative
SPHEROGRAPHIA Des globes virtuels aux blancs des cartes. Une immersion cartographique dans la mise en récit des changements globaux
Coordinateur : Matthieu Noucher, CNRS, PASSAGES
Durée : 48 mois (2022 – 2025)Autres projets financés
Réseau international Chaire UNESCO

ISNoV, « Intervention sociale non violente »
A travers son dispositif de recherche-action et de formation pluridisciplinaires, la chaire vise à co-construire des cadres de références et d’analyse transversaux, ainsi qu’un partage de méthodes d’intervention efficaces pour prévenir, réduire ou gérer les situations à risques ou de violence dans le cadre du travail social (entendu au sens large).
La chaire ISNoV doit notamment participer, grâce à la diffusion d’une culture de la non violence, au maintien d’un accompagnement social et socioculturel de « haute qualité humaine », face aux processus de déshumanisation qui traversent le champ de l’Intervention sociale.
Ce projet propose de réunir une quarantaine de partenaires en Europe, en Amérique Latine et du Nord, en Afrique et au Proche-Orient sur les problématiques liées à la violence, afin de créer une synergie Nord/Sud qui constituerait un levier de transformation directe et de proximité des situations violentes, des rapports sociaux et de la mise en œuvre des politiques publiques afférentes, grâce à la mise en place d’un réseau international de recherche.
Porteur : Pascal Tozzi, PASSAGES
Durée : 48 mois (2022-2026)
Budget total : 45 000€HORIZON-MSCA-2022-PF-01 MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

RIDERS EquestRian OffIcers as an Innovative Tool for Developing a MiDdle-out Approach to Roman ImpERial EliteS (1st-3rd AD)
La société romaine est élitiste par nature et est donc représentée par la plupart des sources disponibles. Les élites impériales romaines sont étudiées depuis longtemps, mais les chercheurs ne se concentrent généralement que sur les deux extrêmes des élites, soit le niveau supérieur (élites employées dans la haute administration impériale), soit le niveau inférieur (élites civiques). Aucune attention n'a été accordée à l'existence d'une "élite moyenne".
Le projet RIDERS propose une enquête innovante sur les élites impériales romaines avec l'objectif ambitieux de changer les modèles d'interprétation traditionnels, en allant au-delà de l'idée d'une élite supérieure et d'une élite inférieure, en développant un modèle d'analyse des élites impériales romaines et une approche novatrice de type "middle-out".
Après plus de trois décennies depuis le dernier travail complet consacré aux officiers équestres, le projet RIDERS aborde à nouveau l'ensemble du corpus des 2 500 officiers équestres afin de développer un outil innovant pour une enquête approfondie sur les moyennes élites impériales. En appliquant une méthodologie multidisciplinaire, fondée sur la prosopographie traditionnelle intégrée à des méthodes sociologiques et soutenue par les humanités numériques, le projet RIDERS développera, comme principaux résultats, la première base de données aux officiers équestres et la première monographie sur les élites moyennes impériales.
L'ambition du projet RIDERS consiste à appliquer également aux élites le concept social de "milieu", habituellement utilisé pour le reste de la société.
Coordinateur : Alberto Dall Rosa (alberto.dalla-rosa @ u-bordeaux-montaigne.fr) - Ausonius
Post-doctorante : Tiziana Carboni - Ausonius
Durée : 24 mois (2023-2025)
Budget total : 211 755 €400 Memories : Transmettre les mémoires autochtones - Exploration d’une cartographie sensible des récits

À la suite de l’irruption d’une crise sociale majeure en Guyane française ayant donné lieu aux « Accords de Guyane » en 2017, l’État français s’est engagé dans une démarche de rétrocession pleine et entière de 400 000 hectares de terres aux communautés autochtones amérindiennes et bushinengue. Depuis lors, une fois les effets d’annonce passés, le processus s’avère complexe. Si un Établissement Public de Coopération Culturelle et Environnemental (EPCCE) est cours de création, de nombreuses questions juridiques et territoriales restent en suspens. Comment identifier ces terres et sur quels critères établir cette rétrocession ? Puisque différentes communautés vivent et cohabitent dans ces territoires, comme justifier la répartition ? Suivant leurs modes de vie et besoins, bénéficieront-elles équitablement de cette rétrocession foncière ?
Coordinateurs : Matthieu NOUCHER/Béatrice COLLIGNON, UMR 5319 Passages
Post-doctorante : Elise Olmedo
Durée : 24 mois (2023-2025)
Budget total : 211 755€Organisation internationale du travail - Genève – accord d’exécution projet international

HaFoP Harcèlement et violences au travail au sein de la fonction publique au Mali et au Sénégal
La Conférence internationale du Travail a adopté en 2019 la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement et la recommandation (n° 206) qui l’accompagne. Ces deux instruments sont les premières normes internationales du travail qui offrent un cadre commun permettant de prévenir, de combattre et d’éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre (une première en droit international pour ce qui est du harcèlement [art. 4 1]). Le projet HaFoP vise à mener à l’approfondissement des connaissances sur les causes et les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail. Le caractère novateur de HaFoP vient de son accent sur les stratégies de mobilisation sur des sujets qui sont considérés par une majorité d’acteurs sociétaux comme non prioritaires. Ces mobilisations sont cruciales dans le processus de transformations sociales.
Coordinateurs : Elisabeth Hofmann, les Afriques dans le Monde LAM et Jean-Christophe Lapouble, CEREGE de Université de Poitiers
Durée : 20 mois (2022 – 2024)
Budget total : 55 593 € de participation financière de l’OiT
Projet en partenariat avec : le groupe d’Études et de recherche Genre et Sociétés (GESTES) de l’Université Gaston Berger de Saint louis (Sénégal) et le Centre des Etudes Sécuritaires et Stratégiques au Sahel (CE3S) au MaliGroupes thématiques numériques 2022-2025

ÆSON, Adopter une Education à la SObriété Numérique
Le projet s’inscrit dans le thème 5 « Éducation, numérique et sobriété numérique, défis environnementaux et enjeux de développement durable » du GTnum 2022-2025 et précisément sur la question de l’éducation à la sobriété numérique. Ce projet repose sur une démarche de recherche appliquée visant à mener des actions de réflexion, d’information et de sensibilisation auprès d’élèves et d’enseignants du secondaire sur les enjeux environnementaux du numérique, en prenant appui sur des travaux de recherche et de veille qui permettront de comprendre les processus informationnels, communicationnels et les usages d’un numérique écologiquement plus responsable et plus sobre dans l’enseignement et l’éducation.
Porteuse : Nadège Soubiale, MICA
Durée : 36 mois (2022-2025)
Budget total : 75 000 €
Projet en partenariat avec : DRANE Région Nouvelle Aquitaine, réseau Canopé, UR Techné de université de Poitiers, IMT Atlantique, LIUPPA, Conseil régional de Bretagne.Agence française de développement - Convention de partenariat stratégique

CANIA Contribution à l’analyse des initiatives de l’intelligence artificielle en Afrique
L’objet de ce partenariat de recherche, proposé par la Chaire Unesco de l’Université Bordeaux Montaigne renouvelée en 2022 « Pratiques émergentes en technologies et communication pour le développement », vise à analyser le contexte de développement des initiatives d'intelligence artificielle en Afrique. Plus précisément il s'agira de réaliser des webséries sur l'intelligence artificielle en Afrique, d'organiser un symposium et de réaliser un ouvrage sur les utilisations émergentes de l'intelligence artificielle en Afrique. La Chaire Unesco concentre ses recherches sur l’analyse des pratiques des TIC dans les pays en développement.
Porteur : A. Kiyindou, MICA
Durée : 14 mois (2022-2023)
Budget total : 55 000 € de participation financière de l’Agence Française de DéveloppementLauréats 2022 de l'institut universitaire de France

Lauréat 2022 IUF senior
- Eric Benoit, professeur en littérature française (XIXe et XXe siècles), PLURIELLES
Comment des expériences négatives peuvent-elles déboucher sur la création littéraire ? Eric Benoit centre sa recherche sur le fonctionnement du retournement dialectique par lequel la négativité est l’origine même d’un processus positif de création littéraire depuis trois siècles, notamment à partir des notions suivantes : l’incomplétude, l’insaisissable, l’inquiétude, l’insoutenable, la consolation. La littérature est ici révélatrice d’un état de sensibilité des XIXe et XXe siècles, jusqu’à aujourd’hui.
Lauréate 2022 IUF junior
- Julia Roumier, maître de conférences en études ibériques de littérature, histoire et iconographie médiévales, AMERIBER
PPOLLUX : Perceptions et pratiques de l’Ostentation et du Luxe (Moyen Âge hispanique). Julia Roumier s’attache à la dimension matérielle et sensorielle du somptuaire pour renouveler l’analyse de cette consommation. Propre à pérenniser la domination, elle affirme d’une différence ontologique des élites en les mettant en scène, les esthétisant. L’étude des pratiques et représentations de cet éthos de la supériorité dans les sources écrites de la fin du moyen âge hispanique (chroniques, biographies, manuels..) éclaire images et objets, révélant un paysage sensoriel et symbolique où les plaisirs sont un marqueur de distinction et un outil de construction du corps social.
L'Université Bordeaux Montaigne vous propose, à titre d'exemple, un panel de projets non exhaustif de sa riche activité.
- Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine
- Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
- AAP Science avec et pour la société – Ambitions innovantes
- AAPG 2023 – PRC -CE27 – Axe D.6 : Études du passé, patrimoines, cultures
- AAPG 2023 – JCJC - Études du passé, patrimoines, cultures (27)
- AAPG 2023 – PRC - CE41 - Les sociétés contemporaines: états, dynamiques et transformations
- AAP Access ERC Starting – édition 2023
- POPSU territoires
- Bordeaux Métropole
- ERASMUS+
- CNRS International Research Networks
- HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01- (A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - 2023)
- Lauréat 2023 IUF junior
Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine

Enseignement supérieur et recherche
MécriNA Les maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine : des lieux de mémoire entre valorisation patrimoniale, enjeux touristiques et création artistique
Le projet MécriNA se propose d’appréhender en quoi les maisons d’écrivain présentes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine constituent un atout exceptionnel pour le rayonnement culturel et touristique de la région.
Porté par des chercheurs en littérature qui travailleront en étroite collaboration avec des responsables de maisons d’écrivain et d’associations littéraires, MécriNA se focalisera sur la manière dont ce patrimoine matériel est un vecteur privilégié du patrimoine immatériel qu’est la littérature. À l’heure où il devient de plus en plus difficile de transmettre le goût de la lecture, les maisons d’écrivain occupent une place originale en matière de démocratisation culturelle.
Porteur : Hélène Claverie Laplace UR ALTER (Arts/Langages : Transitions & Relations) Université de Pau et des pays de l’Adour
Co-porteur : Caroline Casseville UR Plurielles - Centre Mauriac
Durée : 36 mois (2023-2027)
Budget total : 219,5 k€ dont fonctionnement et un financement de thèse (50% région Nouvelle-Aquitaine et 50% Université de Pau et des Pays de l’Adour) et dont 35k€ de fonctionnement pour l’UR Plurielles . Le CRNA finance à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec : ISCJ (l'Institut de Sciences criminelles et de la Justice)de l’université de Bordeaux, l’association MEPLNA, les Maisons d’écrivain Montesquieu Château de La Brède et Maison-musée Edmond Rostand , les associations Académie Giraudoux, Les Amis de Christine de Rivoyre, Maison DruonANADA – Afriques-Nouvelle-Aquitaine : décolonisation des Arts, circulation des biens culturels et restitution du patrimoine africain dans un monde en recomposition.
Porteur : Sophie Chave-Dartoen, Université de Bordeaux, UMR 5319 PASSAGES
Durée : 60 mois (2023-2028)
Budget total : 83 200 € financés par la Région à hauteur de 80%.
Projet en partenariat avec Musée d’Aquitaine, Muséum de la Rochelle, Musée d’ethnographie de Bordeaux, LAM, Musée d’Angoulême, Musée municipal Hèbre de la ville de Rochefort, laboratoire RPSH de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou-Burkina Faso, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord de Périgueux, l’association MC2a, l’association Institut des Afriques, le Musée Sénoufo de Bobo Dioulasso.PSGAR Programmes Scientifiques de Grande Ambition Régionale
CORALI COnnaissances inteRdisciplinaires pour une meilleure Adaptation face aux risques LIttoraux
Le PSGAR CORALI a pour objectif d’apporter des connaissances scientifiques pluridisciplinaires nécessaires à une meilleure prévision des changements et évolutions des littoraux, ainsi qu’à une meilleure anticipation des adaptations sociétales face aux risques naturels d’érosion et submersion de l’interface terre-mer. Les recherches proposées auront un caractère fondamental, de portée internationale, tout en ayant une application directe sur les sites régionaux de la Nouvelle Aquitaine.
Pour cela, le PSGAR mettra en oeuvre une série de recherches et d’expertises (d’observation, de modélisation, d’analyse et d’aide à la décision) pour accélérer la transition vers une société capable de s’adapter et d’être plus résiliente et plus soutenable face aux évolutions actuelles et futures des littoraux ouverts et semi-fermés. Pour faire face à ce défi, accru par le dérèglement climatique, un effort de recherche interdisciplinaire sera favorisé et stimulé.Porteur : Aldo Sottolichio, EPOC UMR OASU, Université de Bordeaux.
Partenaires Université Bordeaux Montaigne : Florence Verdin, UMR 5607 Ausonius, Solange Pupier, UMR 5319 Passages
Durée : 48 mois (2024-2028)
Budget total : 261 000 € financés par la région Nouvelle-Aquitaine dont 45 800€ à l’université Bordeaux Montaigne. Le GPR Human Past finance un an de contrat post doctoral.
Projet en partenariat avec : les laboratoires néo-Aquitains BSE, SIAME, CRIHAM, Institut Pprime, LIENSS, ETTIS, CARDAMOME, RHITME, Unité R3C ; les laboratoires non aquitains ISEN, SHOM IRSN ; les partenaires socio-économiques AEAG, Ville de Capbreton, CCMA, CDL, ainsi que le CEREMA et des organismes de recherche (CNRS, INRIA, INRAE, BRGM) dans le domaine des risques naturels et environnementaux de Nouvelle-Aquitaine, membres du réseau de recherche régional (R3) RIVAGES, dédié à la thématique spécifique des risques littoraux .
Marjolaine Lamoureux est en contrat post-doctoral sur le projet, sous la direction de Florence Verdin à Ausonius de novembre 2025 à octobre 2027.Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

AAP Science avec et pour la société – Ambitions innovantes
INSIDE : Psychiatrie et médias : quand les usagers deviennent (réd)acteurs
Le projet INSIDE vise à faire évoluer le regard de la société sur les troubles psychiatriques, à lutter contre toutes les formes de stigmatisation qui persistent encore aujourd’hui notamment à travers certaines représentations médiatiques. Conçu comme une recherche action participative, il est construit à partir d’un dispositif innovant basé sur le croisement des savoirs pratiques et théoriques entre chercheurs en psychiatrie, en Sciences de l’Information et de la Communication et acteurs des médias, et se déroule « à l’intérieur » même d’un institut de soins psychiatriques Bordelais. L’enjeu est de proposer un regard et une analyse des grandes questions d’actualité qui peuvent recouvrir ceux des grands médias mais également offrir une autre perspective liée à l’expérience de la douleur psychique, de la stigmatisation, parfois d’événements de vie douloureux et à une particulière sensibilité. L’objet est la réalisation d’une revue papier trimestrielle de 12 pages, abordant les grands enjeux sociétaux.
Coordinatrice Université Bordeaux Montaigne : Marie-Christine Lipani, MICA
Co-porteurs : Université de Bordeaux : Marie Daubech-Tournier, BPH ; Association PsyHope, Emmanuelle Douriez, Présidente de l’association
Durée : 24 mois (2024-2026)
Budget total : 121 277€ dont part UBM 39 132€
Projet en partenariat avec : Institut du journalisme Bordeaux Aquitaine ; centre hospitalier Charles Perrens (Bordeaux)AAPG 2023 – PRC -CE27 – Axe D.6 : Études du passé, patrimoines, cultures
ALTIOR Les voûtes de Notre-Dame de Paris et la quête de la hauteur dans l’architecture gothique en France, XIIe-XIIIe siècles
Comment les architectes des cathédrales gothiques ont-ils réussi à construire des voûtes toujours plus hautes ? Comment sont-ils parvenus, en l’espace d’une génération, à passer d’une hauteur d’environ 24 m pour les plus grandes cathédrales des années 1130-1150, à une hauteur de 32 m à Notre-Dame de Paris, entreprise aux alentours de 1160 ? Et comment ont-ils, ensuite, hissé leurs voûtes à 36 m à la cathédrale de Chartres, 37 m à Bourges, 39 à Reims, 43 à Amiens et à Cologne, et jusqu’à 48 m à Beauvais vers 1260-1270 ?
Le projet vise à apporter un nouvel éclairage à l’aventure des cathédrales gothiques, sur un aspect fondamental – la quête de la hauteur – qui n’a plus fait l’objet de travaux de recherche significatifs depuis les années 1980, et pour étudier au moyen des technologies les plus avancées une série de cathédrales majeures pour l’évolution de l’art gothique en France et en Europe, des compétences croisées sont nécessaires. L’approche du projet ALTIOR associe étroitement histoire de l’architecture, archéologie du bâti, archéométrie, géologie, génie civil, géophysique, calcul de structure et sciences du numérique. La complémentarité des partenaires issus des sciences humaines et sociales (SHS), des sciences pour l’ingénieur (SPI) et des sciences du numérique est donc réelle.
Porteur : Yves Gallet, AUSONIUS
Durée : 36 mois (2023 – 2026)
Budget total : 121 266 €
Projet en partenariat avec : IRHIS, université de Lille ; LA3M, Aix-Marseille Université ; IJL, université de Lorraine ; I2M, Université de BordeauxArchArch, L'héritage de l'archéologie: vestiges, traces, mémoires d'une activité scientifique (Maroc, Mauritanie, XIXe-XXIe siècles)
L’archéologie produit, corollairement à son enquête sur les vestiges des sociétés du passé, des traces matérielles et immatérielles significatives dans l’environnement où elle se pratique. L’archéologue remodèle nos représentations des altérités historiques et bouleverse littéralement le paysage et la spatialité des territoires où il intervient comme la vie de celles et ceux qui les habitent. Il est donc le producteur d’une économie scientifique agissant sur le monde de son temps et le nôtre. Son activité « produit » des significations, mais également de nouveaux monuments, des collections d’objets, des archives, en d’autres termes : des vestiges. Nés de l’activité archéologique, ces vestiges peuvent être considérés comme un objet d’étude à part entière. En combinant les compétences de spécialistes de l’histoire et de l’anthropologie des savoirs, du droit et du patrimoine, sans se priver des apports d’une archéologie réflexive, ArchArch interroge ce qu’est l’archéologie après l’archéologie.
Porteur : Clémentine GUTRON (Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales
Partenaire : Baudouin DUPRET, DR CNRS, LAM
Durée : 48 mois (2024 – 2027)
Budget total : 698 137€
Projet en partenariat avec : LAM les afriques dans le monde, ISP institut de sciences sociales du politique, INP institut national du patrimoine, CESHS Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et socialesAAPG 2023 – JCJC - Études du passé, patrimoines, cultures (27)
ALEAMAtlas of the Landed Estates of the Ancient Maghreb. Geography and Analysis of the Property
Comment un empire mondial devient-il dépendant d'une seule région pour son blé ? Pourquoi une région parvient-elle à se distinguer des autres par ses grands domaines agricoles ? L'Afrique du Nord (avec l'Égypte) était le grenier à blé de Rome dans l'Antiquité dès le IIe siècle avant J.-C., mais comment cela s'est-il produit et quel a été son impact réel à différentes époques ?
Le projet ALEAM vise à produire un atlas et une base de données en ligne des propriétés foncières en Afrique du Nord ainsi que deux volumes interprétant les données. La production de l’atlas et de la base de données permettra la réflexion et le dialogue entre les membres du projet afin de rédiger les interprétations les plus justes des données et de les publier.
En effet, le projet se déroulera en deux phases principales (d'une part, la conception numérique de l'atlas/base de données et son remplissage et, d'autre part, l'interprétation et la publication des données en deux volumes d’actes).
Porteur : Hernan GONZALEZ BORDÀS, AUSONIUS
Durée : 48 mois (2024 – 2027)
Budget total : 182 654 €AAPG 2023 – PRC - CE41 - Les sociétés contemporaines: états, dynamiques et transformations
EXILEST - Les exilé.e.s bélarusses, russes et ukrainien.ne.s après l’invasion de Ukraine. Politisations, interactions, solidarités et tensions
Dans les années 2010, le Bélarus, la Russie et l’Ukraine ont connu un accroissement de l’émigration, lié aux contraintes politiques et géopolitiques. Le 24 février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie alliée au Bélarus a provoqué un exode sans précédent de la population ukrainienne (majoritairement des femmes et des enfants), suivi de flux migratoires plus circonscrits en provenance du Belarus et de la Russie. Les raisons de l’exil sont variées : répression politique dans le pays d’origine, déplacements de population résidant dans des territoires occupés ou bombardés, crainte d’être mobilisé. Sans mettre sur le même plan l’exil issu de ces trois pays, la recherche part toutefois du constat que ces populations se croisent et interagissent dans certains lieux, comme en Lituanie, en Pologne, en Géorgie. La recherche analyse les répercussions de la guerre en cours sur les formes individuelles et collectives de politisation et sur les interactions entre les exilés des trois pays impliqués dans le conflit. Les enquêtes se dérouleront en Lituanie, en Pologne, en Géorgie. Le premier objectif est d’étudier les conséquences de la guerre sur les parcours d’exilés, notamment leur dimension genrée et les conditions d’accueil dans les pays d’arrivée. Le deuxième objectif est d’analyser la manière dont la guerre a provoqué et / ou transformé les formes de politisation de ces trois populations (organisations partisanes, mobilisations collectives, médias, réseaux, actions humanitaires). Le troisième objectif est de comprendre les relations entre ces trois populations, en analysant les formes d’interactions, de solidarités et mais aussi de tensions voire conflits, et ce, à quatre niveaux : interactions quotidiennes ; ONG et associations ; médias ; organisations politiques en exil. Enfin, le quatrième objectif est à saisir ces circulations dans leur épaisseur historique.
Porteur : Ronan Hervouet (Centre Emile Durkheim – Science politique et sociologie comparatives-UB)
Partenaire UBM : Olga Bronnicova, Plurielles ; Olga Gille-Belova, CEMMC
Durée : 36 mois (2024 – 2026)
Budget total : 556 416 € dont 123 926 € UBM avec recrutement d'un contrat post doctoral de 15 mois
Projet en partenariat avec : ILCEA4 INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE, AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE ; CERCEC Centre d'Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen ; AAU Ambiances Architectures Urbanités ; CEMMC UR 2958 CENTRE D'ETUDES DES MONDES MODERNE ET CONTEMPORAIN ; MESOPOLHIS Centre méditerranée de sociologie, de science politique et d'histoire ; CED CENTRE ÉMILE-DURKHEIM - SCIENCE POLITIQUE ET SOCIOLOGIE COMPARATIVES ; ISP INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE ; CRH Centre de recherches historiquesAAP Access ERC Starting – édition 2023
ProMeThEuS Protohistoric Metrology Through European Sources
Le projet ProMeThEuS vise à étudier les pratiques de mesure en Europe au cours des âges du Bronze et du Fer (v. -2200/-50 av. n.è.) à partir des sources archéologiques et littéraires. Au cours de cette période, apparaissent des pratiques et des institutions dont le fonctionnement implique l’usage des nombres et des mesures : le commerce, l’urbanisation ou encore la monnaie. Au sein des systèmes de mesure, seule la pesée a fait l’objet d’études approfondies et permet aujourd’hui une bonne caractérisation à partir de l’âge du Bronze moyen (v. 1600-1400 av. n.è.). Dans le cadre du projet ProMeThEuS, ce seront l’ensemble des pratiques de mesure (de masse, de longueur et de volume) qui seront étudiées sur l’espace européen et dans une large diachronie, depuis leur apparition jusqu’à la période romaine.
Cette recherche s’appuiera largement sur les humanités numériques. Les données, de natures très variées seront notamment organisées grâce à une base de données dédiée. L’usage de l’infographie 3D aura pour but de faciliter et améliorer l’acquisition des données métrologiques. Enfin, des mathématiques et statistiques permettront de traiter ces données d’un point de vue métrologique. Il s’agit donc d’un projet hautement transdisciplinaire et les résultats du projet ProMeThEuS permettront de largement renouveler nos connaissances sur l’emploi des nombres et des mesures dans l’Europe protohistorique. Nos représentations des pratiques et institutions socio-économiques s’en trouveront notoirement transformées et enrichies.
Contrat post-doctoral : Thibaud Poigt AUSONIUS
Durée : 24 mois (2023 – 2025)
Budget total : 185 750 €POPSU territoires

Petites villes et campagnes, forment de nouvelles solidarités territoriales
RECREON : « Renaturer Créon : une stratégie bio-régionale levier de solidarités écologique et territoriale »
Comment concilier les objectifs paradoxaux de développement démographique et des emplois, de préservation des espaces agricoles et de nature, de réduction de la consommation d’espace et de renaturation des espaces urbanisés dans les petites villes rurales et péri-urbaines ? Le projet RECREON propose d’expérimenter une approche de projet bio-régionale, experte et citoyenne, pour envisager la renaturation de la commune de Créon dans une double logique de solidarité territoriale et écologique.
Porteuse : Emmanuelle BONNEAU (emmanuelle.bonneau @ u-bordeaux-montaigne.fr), UMR 5319 Passages
Durée : 36 mois (2023-2026)
Budget total : 30 000 €
Projet en partenariat avec : Université de Florence, commune de CréonHabiter les cendres. Les petites villes de la forêt girondine
Cette recherche-action est consacrée aux petites villes forestières et périurbaines affectées par les incendies de l’été 2022 en Gironde dont Belin-Beliet et Saumos. La population a été entièrement évacuée et fait face à un processus de reconstruction. Le projet propose de mener une réflexion sur la question de l’habiter post-catastrophe en étudiant ces communes forestières par une approche de sciences humaines ciblée sur les risques naturels et la gestion du foncier forestier.
Porteuse : Véronique André-Lamat, UMR 5319 Passages
Durée : 36 mois (2023-2026)
Budget total : 30 000€ + 2000€ PSE SAPS
Projet en partenariat avec : l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat), Département de la Gironde et les communes de Belin-Béliet, Saumos, CazauxBordeaux Métropole

Création de zones de ressourcement multi-bénéfices
Bordeaux métropole a inscrit dans son plan de prévention du bruit dans l’environnement une mesure poursuivant l’objectif d’identifier et de préserver les zones calmes sur son territoire et souhaite pousser la réflexion sur l’identification plus spécifique des zones de ressourcement.
Il sera question d’étudier la qualité sonore des espaces paysagers de l'agglomération bordelaise. En s'appuyant sur la directive européenne 2002 "zones calmes", Philippe Woloszyn cherchera à améliorer une méthode de qualification des ambiances sonores sur les territoires paysagés de l’agglomération.
Porteur : Philippe WOLOSZYN, CNRS, ENSAP UMR 5319 Passages
Durée : 24 mois (2023-2024)
Budget total : 70 000€
Projet financé par : Bordeaux MétropoleERASMUS+

Didafé
Le projet de formation et de recherche DIDAFÉ intitulé Former à l’enseignement du français écrit en contexte plurilingue et transeuropéen: enjeux, modèles, pratiques innovantes et inclusives, réunit et fait travailler ensemble des acteurs du monde universitaire ainsi que des praticiens de l’éducation enseignant ou organisant l’enseignement du français et en français. La didactique de l’écriture est abordée, de façon intégrée, par les didacticiens du français langue première, seconde et étrangère. Concrètement, outre le renforcement des coopérations existantes, le projet vise à développer et/ou à renforcer les compétences professionnelles des enseignants et futurs enseignants en didactique du français langue première, seconde et étrangère dans le domaine du français écrit (compréhension et production) via le développement de dispositifs innovants et inclusifs, le partage d’expériences, la mutualisation de ressources théoriques et pédagogiques ainsi que la mise en place d’espaces interuniversitaires de formation initiale et continue.
Pour cela, il s’agira (i) de circonscrire les politiques éducatives et linguistiques des pays partenaires, (ii) d’identifier le rapport aux langues, au français écrit et à son enseignement des groupes cibles ainsi que leurs pratiques d’enseignement du français écrit, (iii) de développer des ressources pédagogiques et (iv) de renforcer les mobilités d’enseignement, de formation et de recherche.Porteur : Maurice Niwese (Université de Bordeaux)
Durée : 36 mois (2024-2027)
Budget total : 250 000 € dont part UBM : 60 440 €
Partenaires : avec le réseau Néo Aquitain sur les francophonies FrancophoNéA, cinq universités y sont impliquées: deux françaises (Bordeaux-INSPÉ et Bordeaux Montaigne) et trois des Balkans (Novi Sad, Tirana et Bucarest). DIDAFÉ rassemble aussi plusieurs organismes publics et associatifs intervenant sur ces problématiquesCNRS International Research Networks
IRN SOUTH - STREAM (Digital South TuRn - Exploring Cultural Platforms Made In Africa, Asia, and Latin AMerica)
L'International Research Network (IRN) SOUTH-STREAM a pour ambition de mener une réflexion collective et critique sur les plateformes culturelles et les acteurs du numérique dans les pays des Suds. Si la littérature sur les plateformes numériques connaît un véritable essor, elle reste largement centrée sur les contextes et acteurs nord-américains et européens (Netflix, Spotify...). L'IRN propose de changer de perspective en se concentrant sur les plateformes des Suds encore sous-étudiées et sous-estimées pour comprendre des dynamiques mondiales plus complexes.
Porteuse : Christine ITHURBIDE, UMR 5319 Passages
Durée : 60 mois (2023-2027)
Budget total : 70 000€ CNRS
Projet en partenariat avec : L’IRN rassemble neuf institutions partenaires - 3 d'Europe (CNRS et LabEx ICCA en France, Université de Leeds au Royaume-Uni), 3 d'Afrique et du Moyen-Orient (Pan-Atlantic University au Nigeria, Stellenbosch University en Afrique du Sud, Université de Galatasaray en Turquie), 2 d'Amérique Latine (Universidad Adolfo Ibáñez au Chili, Universidade Federal do Rio de Janeiro au Brésil) et 1 d'Asie (Tata Institute for Social Sciences en Inde).
https://www.southstream.cnrs.fr/HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01- (A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - 2023)

AUTOMATA AUTOMated enriched digitisation of Archaeological liThics and cerAmics
 Le projet européen AUTOMATA est un projet de numérisation 3D des objets archéologiques. Les objets nous relient à des souvenirs et à des expériences. Ils possèdent des biographies qui révèlent leurs relations humaines. C'est pourquoi les archéologues se concentrent sur la culture matérielle, rassemblant d'innombrables pièces archéologiques afin de préserver ce que nous pouvons apprendre et les histoires qu'elles créent pour les générations actuelles et futures.
Le projet européen AUTOMATA est un projet de numérisation 3D des objets archéologiques. Les objets nous relient à des souvenirs et à des expériences. Ils possèdent des biographies qui révèlent leurs relations humaines. C'est pourquoi les archéologues se concentrent sur la culture matérielle, rassemblant d'innombrables pièces archéologiques afin de préserver ce que nous pouvons apprendre et les histoires qu'elles créent pour les générations actuelles et futures.L'archéologie dévoile ces histoires, permettant aux objets de parler de leurs origines, de leurs utilisations et de leur évolution. Ils offrent un aperçu de la technologie, de la vie quotidienne, des relations, de l'environnement et de l'histoire de l'humanité. La poterie et lespierres lithiques sont des formes courantes de preuves archéologiques, qui contiennent des informations cruciales. Cependant, la documentation et la classification de ces objets demandent beaucoup de travail, cela limite notre compréhension de ces objets. Bien que des campagnes de numérisation aient été entreprises, elles restent complexes, longues et coûteuses, laissant des millions d'objets inaccessibles. AUTOMATA transformera ce processus en permettant une numérisation à faible coût et efficace. Grâce à la robotique et aux capteurs augmentés par l'IA, AUTOMATA créera des modèles 3D enrichis de données archéométriques offrant ainsi une solution pratique et rentable pour la numérisation. Les outils robotiques dotés de méthodologies d’IA amélioreront le processus de numérisation des propriétés visibles et non visibles des découvertes archéologiques, renforceront la robustesse et l'efficacité de la numérisation 3D.Cette technologie rentable démocratisera l'accès à la numérisation, ce qui profitera aux musées et aux petites institutions, facilitera les méthodes de préservation et le travail des restaurateurs, et favorisera le partage des connaissances grâce à une plateforme de crowdsourcing dédiée.
Enfin, les données collectées par AUTOMATA assureront une intégration transparente des données dans le nuage ECCCH et faciliteront le partage des données et les stratégies d'utilisation innovantes par les CCI.
Coordination : université de Pise (Italie)
Partenaire pour l'université Bordeaux Montaigne : Rémy Chapoulie, Archéosciences Bordeaux
Durée : 54 mois (2024-2028)
Budget total : 4,888 M€ dont 605 175 € pour l’Université Bordeaux Montaigne, Archéosciences Bordeaux
Projet en partenariat avec : 12 partenaires : Universita di Pisa (IT), Université Bordeaux Montaigne (FR), University of York (UK), INRAP (FR), Arheoloski Muzej U Zagrebu (HR), Qbrobotics srl (IT), The Hebrew University of Jerusalem (IL), Miningful srls (IT), King’s College London (UK), Fondazione Istituto Italiano di Technologia (IT), Universitat de Barcelona (ES), Culture Lab (BE)site web : http://automata-eccch.eu/
Les 3 et 4 février 2026, l’Université Bordeaux Montaigne et Inria accueilleront une trentaine de membres du consortium du projet européen AUTOMATA. Ces rencontres seront marquées par des réunions scientifiques et des visites de laboratoires.
Lauréat 2023 IUF junior

Pauline Beaucé (pauline.beauce @ u-bordeaux-montaigne.fr), maitresse de conférences en études théâtrales, ARTES
- L’enfant sur scène : une autre expérience du spectacle en France (1769-1807)
Pauline Beaucé entend contribuer de manière originale à l’histoire des spectacles en étudiant les théâtres publics d’enfants qui se sont développés en France au tournant des Lumières. La présence d’enfants sur scène pour des spectateurs adultes suppose des conditions architecturales, esthétiques et sociales inédites. Par l’étude de sources variées (manuscrits littéraires et musicaux, archives notariales et policières, plans d’architecte) et à l’aide d’outils numériques (3D, VR), il s’agira d’explorer les enjeux de l’enfant-artiste en marge des scènes institutionnelles à Paris, en province et dans l’espace caribéen.
- Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine
- Priorités régionales 3 - Soutenir des projets de sciences participatives pour renforcer les interactions science-société
- Enseignement supérieur et recherche
- Le PSGAR Energie répondant à la problématique posée par la Région : Contribution de la Nouvelle-Aquitaine à la souveraineté énergétique nationale juste et bas carbone
- Inter Régions
- Projets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)
- Autres AAP nationnaux
- Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer
- European Research Council
- International
- IUF Institut Universitaire de France
Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine

Priorités régionales 3 - Soutenir des projets de sciences participatives pour renforcer les interactions science-société
Des écritures théâtrales contemporaines en langue française en mutations au 21e siècle
Le projet E.T.C. 21 porte sur les écritures théâtrales du 21e siècle (2015-2027). Il fédère 5 équipes de recherche plurisdisciplinaires en arts et en littérature et 1 équipe structurante en études de genre.
Le maillage institutionnel culturel de la région Nouvelle-Aquitaine, avec de nombreux lieux impliqués dans l'accueil des auteurices et la diffusion de leurs écritures (l'OARA, le TnBA, L'Union, Le Méta, La Lucarne, la Villa Valmont, les Francophonies, le festival Chahuts, le comité de lecture du Méta), constitue un terrain propice à ce projet qui vise à développer des compétences d'analyse de ces textes et de leur contexte de production, de création et de diffusion. Le projet se déroulera selon trois axes : les représentations (axe « Écrire, Décrire, Témoigner ») ; la production, la création et la diffusion (axe « Produire, Créer, Diffuser ») ; la valorisation et la médiation (axe « Connaître, Enseigner, Transmettre »).
Il s'inscrit pleinement dans les sciences participatives et se positionnera à différents niveaux, du point de vue des participant·es puisqu'il fera intervenir aussi bien des universitaires que des acteurs de la société civile (auteurices, enseignant·es du secondaires, chargé·es des relations avec les publics des théâtres) et du point de vue des espaces où les actions et événements seront proposé·es (théâtres, lieux de résidence d'écriture, festivals, comités de lectures, etc.). Ce qui favorisera les contacts et échanges avec la société civile.
Porteur : Pierre (Pierre.Katuszewski @ u-bordeaux-montaigne.fr)Katuszewski (Pierre.Katuszewski @ u-bordeaux-montaigne.fr), professeur université Bordeaux Montaigne, UR 24141 ARTES
Partenaires établissement : UR 24142 Plurielles, programme de recherche structurant BIGenre
Durée : 48 mois (2024-2029)
Budget total : 216 995 € dont fonctionnement financé à hauteur de 80% par le CRNA et un financement de thèse (50% région Nouvelle-Aquitaine et 50% Université Bordeaux Montaigne)
Projet en partenariat avec : Université de Poitiers/FoReLLIS UR 15076, UPPA/ALTER UR 7504, Université de Toulouse/LLA CREATIS et les partenaires socio-économiques : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine Méta-CDN de Poitiers Théâtre de l'Union (Limoges) OARA Villa Valmont Théâtre de la Lucarne Festival Les Francophonies Éditions Komos PRÉAC Nouvelle-Aquitaine.Enseignement supérieur et recherche
INSTEAD INvestigations à SainT-Emilion et à Aubeterre-sur-Dronne
Le projet vise à explorer, observer, analyser les églises creusées dans la roche calcaire de Saint-Émilion et d’Aubeterre-sur-Dronne aux XIe et XIIe siècles, à travers une étude interdisciplinaire qui mêle les sciences archéologiques, l’histoire et l’histoire de l’art, la climatologie et la géologie.
Il s’agit de comprendre les spécificités de ce type de sanctuaires souterrains propres à un milieu particulier. Quelles sont les questions de conservation et de préservation qui se posent, compte tenu des contraintes géophysiques, hydrogéologiques et biologiques, ainsi que de l’évolution de leurs usages (funéraire, cultuel, extractif, touristique…). Pour la première fois, les données archéométriques, géophysiques, géologiques, biologiques des deux sites seront réunies, confrontées et analysées. De plus, un support 3D alimentera un SIG pour organiser les données recueillies, les visualiser (restitutions 3D) dans l’espace et les interroger.
Le projet s’appuie sur le PCR « Les sanctuaires souterrains de Saint-Émilion » et sur un réseau de partenaires multi-discipline et inter-universitaire
Porteur : Rémy Chapoulie (Remi.Chapoulie @ u-bordeaux-montaigne.fr), professeur ARCHEOSCIENCES Bordeaux UMR 6034
Durée : 36 mois (2024-2027)
Budget total : alloué par la Région NA 236 000 € dont une demi-allocation doctorale et un demi contrat post-doctoral sur une assiette éligible de 389 000 €
Projet en partenariat avec : Bordeaux INP (I2M), DRAC NA, Éveha, Hadès, Municipalité de Saint-Émilion, Municipalité d’Aubeterre-sur-Dronne, Conservation régionale des monuments historiques (CRMH)GOUPIL – Produire pour vendre : les estampes et les photogravures de la maison Goupil à l'âge de la Révolution industrielle
Le projet « GOUPIL vise à renouveler l’étude de la collection de la maison Goupil en portant l’accent sur l’analyse matérielle des estampes et des photogravures tout en replaçant cette dimension dans son contexte historique, technique, esthétique, économique et social. La force de ce projet réside dans la réunion de différentes disciplines, de musées, d’associations locales, d’éditeurs et d'un public varié autour d'une même collection pour apporter des connaissances sur les multiples aspects de la démocratisation de l’art au XIXe siècle et – sujet très actuel – sur l’affirmation d’une culture de masse et les prémices de l’industrie culturelle.
Le musée bénéficiera d’un apport sur la connaissance et la valorisation d’une collection d’un grand intérêt patrimonial trop peu étudiée, en particulier dans ses aspects matériels, essentiels pourtant, puisque le XIXe siècle connait de multiples mutations techniques.
L’attrait des citoyens pour le musée d’Aquitaine et pour le Musée des beaux-arts devrait être suscité par l’exposition d’une partie de la collection, suivie d’un colloque international, organisée en 2027 et par les différentes activités de science ouverte qui seront proposées (séminaires, ateliers, journées du patrimoine…
Porteur : Aurélie Mounier (Aurelie.Mounier @ u-bordeaux-montaigne.fr), Ingénieure de recherche HDR ARCHEOSCIENCES Bordeaux, CNRS
Partenaires établissement : CRHA , Formation Master Patrimoine et Musée (Archimuse)
Durée : 36 mois (2024-2027)
Budget total : alloué par le Région NA : 118 978 € dont une demi allocation doctorale sur une assiette éligible de 195 973€
Projet en partenariat avec : l'Institut de Chimie & Biologie des Membranes & des Nano-objets de l'université de Bordeaux et le Musée d'Aquitaine.Le PSGAR Energie répondant à la problématique posée par la Région : Contribution de la Nouvelle-Aquitaine à la souveraineté énergétique nationale juste et bas carbone
CERENA : Contribution de la Nouvelle-Aquitaine à la souveraineté énergétique nationale juste et bas carbone
le PSGAR CERENA a pour ambition de permettre à la Région Nouvelle-Aquitaine de contribuer à la transition énergétique de la France par un ressourcement scientifique de haut niveau et ancré dans le territoire. Cette transition énergétique impliquera d’avoir su, à l’horizon 2050, à la fois substituer des énergies non carbonées au pétrole et au gaz, et réduire la consommation globale d’énergie par plus de sobriété et d’efficacité énergétique. Une part importante des énergies renouvelables nécessaires à cette transformation sera produite ou récupérée localement, multipliant par conséquent les points d’injection d’énergie dans les réseaux. Le recours massif aux énergies renouvelables localement implantées implique que les collectivités territoriales soient au cœur de cette transformation. Il est donc logique que ces territoires occupent une place centrale dans le programme CERENA.
Sur cette base territoriale, les problématiques scientifiques sont structurées en 3 parties : couverture territoriale et appropriation, communautés d’énergie et stockages. Besoin de transfert de démarche méthodologique / de partage d'expériences.

Porteur : Evelyne Robert et Pierre Sézac, Université de Pau et des Pays de l’Adour
L’université Bordeaux Montaigne s’investie dans le projet par le biais de sa chaire RESET (réseaux électriques et sociétés en transition) rattachée au CEMMC. Stéphanie Le Gallic (Stephanie.Le-Gallic @ u-bordeaux-montaigne.fr), responsable scientifique, Lucas Lopez (Lucas.Lopez @ u-bordeaux-montaigne.fr), chargé de projet, Pauline Romary (Pauline.Romary @ u-bordeaux-montaigne.fr), chargée de projet sobriété.
Durée : 36 mois (2025-2029)
Budget total : Le budget global du programme est de 6,6 millions d’euros, avec 4,5milions d’euros de dépenses éligibles et une demande de financement à la Région Nouvelle Aquitaine de près de 2,2 millions d’euros (2 155 702,5€ en fonctionnement et 55 000€ en investissement. Les acteurs socio-économiques contribuent fortement au programme de recherche avec une implication à hauteur de 825k€.
Projet en partenariat avec : consortium de 19 laboratoires académiques des 5 sites universitaires de la région Nouvelle Aquitaine dont 7 de SHS, 3 centres de transferts, 6 partenaires privés, 4 agglomérations et 1 CCSTI. Consortium avec les 13 syndicats d'énergie départementaux de la région NA.
En lien avec le réseau 3R TESNA porté par l’université de Pau et des Pays de l’AdourInter Régions

Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi Navarre (INTERREG POCTEFA)
HEZHI - Promotion du plurilinguisme et de l'apprentissage des langues dans l'éducation pour réduire la barrière linguistique dans l'espace transfrontalier : Hezkuntza eta Hizkuntza
Le plan stratégique de l'Eurorégion (2021-2027) donne la priorité à la promotion du multilinguisme en favorisant l'apprentissage des langues sur le territoire pour une citoyenneté cohésive et en surmontant les barrières linguistique. En améliorant l’égalité d’accès à des services inclusifs et de qualité dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en ligne.
La collaboration entre les entités du consortium assurera la cocréation de méthodologies, de contenus et d'outils pour l'éducation plurilingue, en utilisant les ressources existantes et les connaissances générées au cours du projet.Projet coordonné par GECT Eurorégion Aquitaine Euskadi Navarre
Porteur UBM : Argia Olçomendy, IKER
Durée : 48 mois (2025-2029)
Budget total : 1 084 863,27€ dont part UBM 313 231,8€. Projet co-financé à 65% par l'Union européenne à travers l’appel à projets AFOMEF POCTEFA du Programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre.
Partenaires : Consortium de 9 entités partenaires et de trois entités associées. Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco ; Gobierno De Navarra - (Departamento De Educación Servicio De Plurilingüismo Y Enseñanzas Artísticas) ; Universidad del País Vasco/Euskal Herriko ; Huhezi S. Coop. Mondragon Unibertsitatea - (Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación De Mondragon Unibertsitatea) ; Universite Bordeaux Montaigne - (Departement D’etudes Basques Umr 5478 IKERProjets financés par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

 France 2030
France 2030Projet DECRIPT (Dispositif d'étude des crises et des récits civilisationnels par la pluridisciplinarité et les terrains)
Le projet explore les crises civilisationnelles sous une perspective interdisciplinaire et s'appuie sur des recherches approfondies sur le terrain. Il vise à développer une expertise et des outils opérationnels sur la mobilisation et les effets des récits civilisationnels dans les crises géopolitiques contemporaines. Pour ce faire, DECRIPT s'appuiera sur un ambitieux programme scientifique ciblé sur 4 aires clés de conflits majeurs pour la France et l’Europe : Indo-Pacifique, Afrique, Ukraine et ancien monde soviétique, Proche-Orient et Moyen-Orient.
C’est plus particulièrement son expertise sur l’aire indo-pacifique, dont la Chine, que l’Université Bordeaux Montaigne apportera dans ce vaste consortium, notamment grâce aux chercheuses et chercheurs de l’équipe D2IA.
Porteur : Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Delphine Alles
Partenaires : Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Lille, Science Po Paris, Université Bordeaux Montaigne, Université de Strasbourg, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Université Sorbonne Nouvelle, Université Paris Panthéon-Assas, Université PSL (Paris Sciences et Lettres)
Organismes de Recherche : CNRS, Institut de recherche pour le développement
Durée : 84 mois (2025-2032)
Budget total : 9 millions
L'unité de recherche D2IA bénéficie d'un contrat post-doctoral de 12 mois (sept. 25-août 26) pour Alexandre GandilProjet HERMES (Héritage, Exploration et Rénovation des Mémoires et des Espaces Socioculturels)

Un écosystème de recherche dédié aux patrimoines artistiques et linguistiques en devenir. Ce projet se concentre sur la valorisation et la transmission des patrimoines culturels. En mobilisant des approches innovantes, il vise à renforcer la compréhension et la mise en valeur des ressources culturelles, matérielles et immatérielles.
Parmi les nouvelles formes de patrimoine, HERMES se concentre sur les créations artistiques contemporaines (arts de la scène, études cinématographiques, littérature, musique, arts visuels, l’innovation muséale), les productions culturelles numériques, les patrimoines linguistiques et les patrimoines minorés (formes culturelles populaires, etc.).
L’implication de l’Université Bordeaux Montaigne est plus particulièrement axée sur le patrimoine des langues minoritaires et en particulier le basque, le corse, le breton et les langues ultramarines (langues polynésiennes, kanak, amérindiennes…).
Porteur : Université Sorbonne Nouvelle
Partenaires : CNRS, CY Cergy Paris Université, l’Université Rennes 2, l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université Paris 8, l’INALCO et Avignon Université
Durée : 84 mois (2025-2032)
Budget : 9 MillionsAAPG 2024 – PRC CE27 – Axe D.6 : Études du passé, patrimoines, cultures
EFFIGY Images de soi : monuments funéraires à effigies du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles)
Si l’on a souvent associé l’émergence de l’individu en Occident à la modernité, les recherches récentes mettent en évidence que les derniers siècles du Moyen Âge ont joué un rôle fondamental dans ce processus. Le projet EFFIGY entend contribuer à cette réflexion en s’intéressant à la résurgence, autour de 1200, d’une représentation du défunt sur les tombes, gravée ou en ronde-bosse : il tentera ainsi de mettre en lumière les marqueurs et les facteurs d’une mise en scène de l’individu à travers un domaine complexe de la commande artistique des élites, à la charnière entre représentation individuelle et collective, entre enjeux temporels et eschatologiques. Le projet EFFIGY propose de mener l’étude systématique de près de 500 tombes « effigiées » produites entre le XIIIe et le XVe siècle dans trois régions françaises clés : la Nouvelle-Aquitaine, les Pays-de-la-Loire et la Bretagne. Cette aire géographique s’illustre en effet par l’importance du patrimoine conservé ainsi que par la présence d’élites religieuses et laïques variées qui garantissent une approche complète et exigeante du phénomène étudié. Les tombes feront l’objet d’une étude interdisciplinaire intégrant histoire de l’art, histoire des techniques, archéologie expérimentales, épigraphie, emblématique et archéométrie. Le traitement de l’ensemble des données ainsi que la restitution virtuelle de certaines tombes lacunaires ou démembrées bénéficieront de l’apport des humanités numériques.
Pour répondre à ses objectifs, le projet EFFIGY unit l’expertise et les équipements de trois UMR partenaires, réputées tant pour la médiévistique que pour les humanités numériques (Ausonius, le CESCM et le CReAAH-LARA). Ce consortium bénéficiera de l’expertise d’autres unités situées sur les mêmes pôles universitaires, spécialisées en restitution 3D du patrimoine et en science des matériaux.
Porteur : Haude Morvan (Haude.Morvan @ u-bordeaux-montaigne.fr), MCF AUSONIUS
Durée : 48 mois (2025 – 2029)
Budget total : 547 557 €
Projet en partenariat avec : CReAAH-LARA, Nantes Université ; CESCM, Université de PoitiersEXHUM - Explorer la datation directe de dents humaines fossiles par imagerie isotopique des séries de l'uranium
Les dents sont des parties du squelette qui sont mieux conservées au fil du temps. Lorsqu’ils sont d’origine humaine, l’étude de leurs caractéristiques morphologiques, géochimiques et génétiques fournit des informations précieuses sur l’évolution des lignées humaines, les paléoenvironnements dans lesquels vivaient les groupes humains et les interactions qu’ils avaient entre eux. La question de leur datation est tout aussi importante, puisque l’emplacement précis de ces restes sur une échelle de temps générale permet d’exploiter encore davantage toutes ces informations. Dans le projet EXHUM, l’ ambition est de proposer une datation en développant une approche basée sur l’imagerie isotopique, c’est-à-dire en mesurant directement, sans prétraitement chimique, les radioisotopes de la série U présents dans les différents tissus d’une dent.
Porteur : Norbert Mercier, Directeur de recherche CNRS, Archéosciences Bordeaux UMR 6034
Durée : 48 mois (2025 – 2029)
Budget total : 441 147,26€ dont 299 590€ à Archéosciences
Projet en partenariat avec l’UMR 5254 IPREM, Université de Pau et des Pays de l’AdourTHERESA – Approche diachronique des techniques de restauration des maçonneries en brique d’Occitanie : pour un dialogue entre science et histoire (XVe-XXe siècle)
Le projet THERESA ambitionne de produire une connaissance inédite sur l’histoire des techniques d’entretien et de restauration des maçonneries de briques du XVIe siècle à nos jours, pratiquées dans l’actuelle Région Occitanie. L’objectif est à la fois de caractériser l’usage des terres cuites architecturales (provenance et propriété des briques, modes d’appareillage, mortiers, traitements des épidermes, décors structurels et appliqués), d’analyser les altérations qui affectent ce matériau dans sa mise en oeuvre maçonnée, et d’établir quels ont été les principes et les méthodes d’entretien, de restauration et de conservation développés jusqu’à nos jours. Il s’agit d’une recherche-action inédite pour l’architecture de terre cuite, qui vise autant la production d’un savoir fondamental que le développement de nouvelles pratiques par la mise en relation de chercheurs avec des professionnels.
Porteur : Rémi Papillault, : LRA – ENSA Toulouse
Partenaires : Ayed Ben Amara, MCF Archéosciences Bx UMR 6034, UMR 5136 FRAMESPA ; CRESEM ; UMR 5608 TRACES
Durée : 48 mois (2025 – 2029)
Budget total : 642 648€ dont 131 603€ à ArchéosciencesAAPG2024 PRC Axe D3 Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et transformations
ProMétUrba21 - Architectes, urbanistes et paysagistes face aux défis du 21e siècle,
Toutes les approches concernant les métiers de la fabrique de la ville et des territoires notent le moment de mutation très particulier que connaît ce domaine d’activité depuis une vingtaine d’années. Plusieurs mouvements se superposent : la préoccupation environnementale et la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre l'artificialisation des sols, une organisation et une mondialisation des acteurs de l’immobilier et de la construction qui se conjuguent avec, dans de nombreux pays industrialisés, une financiarisation du secteur, un recul de la commande publique d’édifices emblématiques, un tournant participatif et une valorisation de la qualité de réponse des espaces habités à la diversité des usages qui s’y déploient, qui supposent de la part des praticien·ne·s des compétences accentuées d’écoute et d’ouverture de la démarche de conception ; un tournant numérique qui questionne les modalités de conception et de gestion urbaines et, dans ces processus, les places réciproques des acteurs dits traditionnels de la fabrique de la ville et des territoires, les compétences mobilisées et les valeurs défendues . Les groupes professionnels intervenant dans ce domaine sont nombreux. Nous avons choisi ici de nous centrer sur les trois groupes princeps que sont les architectes, les urbanistes et les paysagistes. Notre approche repose sur le choix original de les traiter ensemble, malgré leurs différences. Notre projet se propose de mieux comprendre comment cet ensemble répond aux injonctions et défis du 21e siècle. Cette analyse croisera les dynamiques internes aux trois groupes professionnels, comme celles de leur féminisation, de l’évolution de leur recrutement socio-démographique et de la diversification voire la segmentation de leurs pratiques.
Co-responsable Axe 2 (Continuités et ruptures dans les trajectoires, face à un contexte d’exercice en recomposition) : Jean-Michel Roux, UMR5319 Passages
Durée : 36 mois
Budget total : 366 629 € gérés par 4 partenaires
Projet en partenariat avec ENSA Paris-La-Villette, ENSA Nantes, ENSA Bretagne, ENSA Grenoble, ENSA Toulouse, ENSA Bretagne/Malaquais, ENSA Clermont-Ferrand, ENSA Normandie, ENSA Lyon, Institut Agro Rennes-Angers, Université Bordeaux Montaigne, Université de Rennes 2, ESPI Bordeaux, Université Picardie Jules Verne, ESPI Paris, Université Paris Nanterre, ENSP Versailles-Marseille, Université Toulouse 2, MC-DEPS.Autres AAP nationnaux
AAP ADEME Vers des bâtiments responsables 2024
DREauP-Obs : Dynamiques de consommation et Référentiels de l’Eau : des Pratiques des usagers aux transformations de services - Observations in situ des pratiques et dynamiques des consommations d’eau domestiques-
Dans le contexte actuel de tension sur la ressource en eau, et en réponse aux mesures annoncées dans le Plan Eau (2023), le projet DREauP-Obs vise ainsi à éclairer l’action publique en matière de sobriété. Il a pour premier objectif d’actualiser les données de consommation d’eau potable dans les bâtiments résidentiels pour mettre à jour le référentiel de répartition de ces consommations par usage domestique. Le second objectif vise à observer les évolutions de consommation dans le temps et à en analyser les mécanismes, les moteurs et les contraintes.
Afin de connaître les pratiques et les usages domestiques d’eau potable, ainsi que leur structuration, plusieurs centaines de foyers seront instrumentés dans une vingtaine de collectivités réparties en France métropolitaine pour, d'une part collecter en temps réel les données de consommation d’eau potable, et d'autre part attribuer ces consommations à un usage. Ces mesures in situ seront complétées d’enquêtes de sciences sociales auprès des ménages afin d’éclairer la structure des pratiques et les dynamiques de consommation, les perceptions sociales et les intentions en matière de réduction des consommations. Enfin, un dispositif expérimental de psychologie sociale portant sur des leviers sociotechniques et cognitifs de réduction des consommations d’eau potable sera mis en place pour évaluer l’efficacité des dispositifs d’incitation aux économies d’eau.
Porteuses : Sandrine Courvoisier et Sandrine Vaucelle, UMR 5319 Passages
Durée : 36 mois
Budget total : 282 941€ dont 17 852€ pour Passages
Projet en partenariat avec : CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE BATIMENT), Equipe ETTIS (INRAE NOUVELLE AQUITAINE BORDEAUX), UPR CHROME (UNIV NIMES) et 20 collectivités ayant la compétence eau potableAAP du festival FACTS 2025 : Influence(s)
« L’art de l’enquête »
Cette résidence s’effectue dans le cadre du programme Arts et Sciences de l’IdEx Bordeaux, dont l’objectif est de mettre en place un projet de co-création scientifique et artistique en lien avec la société, qui sera accompagné d’actions de médiation. L’Artiste Résidente travaille à la réalisation d’une performance qui mettra en récit le processus de recherche-création de la résidence « L’art de l’enquête ». L’équipe scientifique, à travers une mise en commun pluridisciplinaire, va créer une coproduction des savoirs liée aux pratiques d’enquêtes. Ce projet de résidence permettra d’une part à l’équipe du laboratoire Passages de découvrir de nouvelles ressources pouvant être utile à la méthode d’enquête via des échanges avec le Collectif Rivage et les autres intervenants. Le Collectif Rivages pourra développer un récit et des temps de médiation sur la pensée critique suite aux échanges avec l’équipe scientifique et les temps d’ateliers.
Porteur : Steven Prigent, UMR5319 Passages (responsable scientifique) et Maëliss Le Bricon (artiste résidente)
Durée : 9 mois
Budget total : 14 000€
Projet en partenariat avec : le Collectif Rivage"Ambimuse"
Cette résidence s’effectue dans le cadre du programme Arts et Sciences de l’IdEx Bordeaux, dont l’objectif est de mettre en place un projet de co-création scientifique et artistique en lien avec la société, qui sera accompagné d’actions de médiation. L’Artiste Résidente travaille à la réalisation d’œuvres sonores et proposera des temps de balades sonores et des siestes musicales lors du festival FACTS. L’équipe scientifique analysera les informations sur les paysages sonores étudiés. Ce projet de résidence permettra d’une part à l’équipe du laboratoire Passages de découvrir de nouvelles ressources pouvant être utile à la recherche via des échanges avec la Compagnie Aïla. D’autre part, des échanges avec du public sur place permettra de collecter des paroles sur l’environnement sonore. La Compagnie Aïla pourra également composer une pièce musicale en lien avec la recherche et la cartographie sonore créée par l’équipe de recherche
Porteur : Philippe Woloszyn, UMR5319 Passages (responsable scientifique) et Marine Ciana (artiste résidente)
Durée : 9 mois
Budget total : 14 000€
Projet en partenariat avec : la Compagnie AïlaMinistère de l'Intérieur et des Outre-Mer
MATRIOSCIA. Matrice Osint pour les cas d'usage de l’IA
Le projet a pour but de saisir les évolutions des méthodologies OSINT (Open source Intelligence) en lien avec le développement des technologies de l’IA. L’OSINT désigne de façon générale les méthodes, outils et analyses qui se basent sur des informations directement accessibles en ligne (Le Deuff, 2021a). Différents acteurs utilisent et mobilisent l’OSINT dans leur domaine professionnel ou à titre amateur. La popularité croissante de ces méthodes et outils nécessite une étude approfondie pour comprendre les tendances, enjeux et risques associés.
Le projet MATRIOSCIA s’inscrit au dans la perspective d’un observatoire de l’OSINT (Osintoscope) en train de se mettre en place au sein de l’Université Bordeaux Montaigne.Porteur : Olivier Le Deuff (Olivier.Le-Deuff @ u-bordeaux-montaigne.fr), MICA
impliqués Université Bordeaux Montaigne : Rayya Roumanos et Clémennt Borel, MICA
Durée : 14 mois (2024-2025)
Financement : 37 080 euros (dont recrutement d’un ingénieur d’études)
Projet en partenariat avec : les laboratoires GEODE (Paris 8 lauréat IUF), et SIC LAB méditerranée (Univ Côte d'Azur)European Research Council
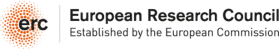
ERC-2021-STG - ERC STARTING GRANTS
PEOPLE PalaeoEcology and OPen-LandscapE adaptations of Pleistocene humans in South Africa Homo sapiens en Afrique au début du Middle Stone Age
Le début du Middle Stone Age est marqué par des innovations technologiques dans la création d’outils et par de nouvelles preuves du comportement symbolique. Il s’agit du moment où les humains dotés d’une anatomie moderne sont apparus en Afrique et se sont installés dans un plus grand éventail d’écosystèmes (y compris des déserts, des forêts tropicales et des montagnes) par rapport aux précédents hominines. Pour survivre, les premiers humains ont dû adapter leurs stratégies de subsistance à l’évolution de leurs environnements. Le projet PEOPLE, financé par l’UE, s’intéressera aux écosystèmes sud-africains pour étudier la répartition des humains et leur adaptation au changement climatique dans le Sud de l’Afrique. Un facteur clé affectant cette réponse est la disponibilité en eau douce. Le projet examinera comment et quand les humains modernes se sont installés sur le sous-continent en cherchant des dépôts archéologiques dans les rivières, les sources et les lacs asséchés en Afrique du Sud.
Porteur : Michael Toffolo, Directeur de recherche CNRS, Archéosciences Bordeaux
Le projet a été déposé et obtenu au Centro nacional de investigacion sobre la evolucion humana en Espagne. Le porteur Michael Toffolo a rejoint le laboratoire Archéosciences Bordeaux en octobre 2024 après avoir été recruté directeur de recherche au CNRS.
Durée : 5 ans (septembre 2022-Août 2027)
Budget total : € 1 499 856 dont un contrat post-doctoral (2025-2027) pour Benoit Longet.HORIZON-MSCA-2024-DN-01

TRANSCEND Transcending limitations of translational research on Multiple Sclerosis and Autism Spectrum Disorder - Spectral, brain-related disorder, patient outcomes, cognition, effect, symptoms
TRANSCEND rassemble des compétences en matière de recherche biomédicale, informatique, comportementale, clinique, épidémiologique et philosophique afin de faire progresser la recherche translationnelle en médecine.
TRANSCEND vise à compléter l'ordre chronologique et épistémique de la recherche, du laboratoire au chevet du malade et à la pratique, par une compréhension de la traduction davantage fondée sur les réseaux. Ceci est particulièrement important pour la recherche translationnelle sur les maladies neurologiques complexes et chroniques.
La plupart des modèles de recherche ne sont pas adaptés à la prise en compte des résultats pertinents pour le patient, de la complexité biologique et sociale de ces conditions, et leurs implications dans le monde réel des soins de santé, parce que leur épistémologie est orientée vers la purification et la réduction des questions de recherche, des modèles de maladie et de l'information sur les maladies.
TRANSCEND propose une approche intégrative de la recherche translationnelle qui englobe la complexité et la diversité des manifestations biologiques, cliniques et sociales des maladies neurologiques, au lieu de les réduire.Coordination : Aarhus Universitet Denmark
Porteur UBM : Steeves Demazeux, SPH
Durée : 48 mois (2025-2029)
Budget total : 4 023 427,32€ dont 314 669,16€ Université Bordeaux Montaigne
Partenaires : 10 établissements partenaires dont l’université Bordeaux Montaigne et 12 établissements associésInternational
Coopération GIZ
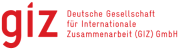
Intégration d’approches participatives dans les programmes d’études des universités sélectionnées du Togo et création de stratégies innovantes pour le développement créatif.

Dans le cadre du projet de coopération, des approches issues de la théorie du réseau, de la communication participative et de l’apprentissage social seront combinées et transférées vers des innovations en matière de durabilité pour la société dans son ensemble à l’aide d’outils et d’innovations numériques. Il s’agit de donner aux groupes cibles (professeurs et étudiants des universités de Lomé et de Kara) les moyens de participer activement aux discussions et processus dans divers domaines de la société. Dans le domaine de l’éducation, l’approche inclut l’ancrage et l’enseignement des formes démocratiques de participation communicative dans les programmes d’études des universités de Lomé et de Kara. L’utilisation de médias numériques pour la communication participative est également incluse - l’outil Moodle déjà utilisé par les universités mentionnées ci-dessus peut être utilisé à cette fin. Parallèlement, des formats de collaboration innovants (tels que les hackathons, les makerspaces ou les FabLabs) seront utilisés pour permettre aux étudiants de tester leurs connaissances et de développer et mettre en œuvre leurs propres idées de manière créative.
Les chercheurs de l’université Bordeaux Montaigne, unité de recherche MICA, contribuent au projet avec leur expertise en Sciences de l'Information et de la Communication en particulier des médias.
Porteur UBM : Etienne Damome, MICA
Porteur : Gesine Lenore Schiewer, Université de Bayreuth (Allemagne)
Durée : 12 mois (1er sept 24- 31 août 25)
Budget : 44 999, 94 €. Financeur : GIZ Funding Agreement
Projet en coopération avec : Université de Bayreuth (Allemagne) et Université de Lomé (Togo)Coopération France-Québec - Programme Samuel de Champlain

Les pratiques et les usages de l’intelligence artificielle générative en bibliothèque universitaire dans le contexte de la transition écologique en France et au Québec : Étude comparée et prospective collaborative
La problématique de recherche s'articule autour de la nécessité urgente de concilier les avantages potentiels de l’intelligence artificielle générative (IAGen) avec les risques éthiques, sociaux et environnementaux associés [1], dans le contexte des bibliothèques universitaires en France et au Québec. L'arrivée de l'IAGen, incarnée par des outils comme ChatGPT, a profondément transformé les pratiques informationnelles des étudiants [2], des enseignants et chercheurs en milieu universitaire [3] suscitant à la fois fascination et inquiétude. Alors que ces acteurs explorent diverses applications de l'IAGen pour soutenir l'étude, la recherche et l'enseignement, les bibliothèques universitaires se trouvent à un carrefour crucial [4]. Ces bibliothèques doivent non seulement adapter leurs pratiques, services, équipements et stratégies pour intégrer cette nouvelle technologie [5], mais également évaluer les répercussions de l'IAGen sur ces différents aspects, dans un contexte où la transition écologique devient également incontournable. Cette étude permettra, dans un premier temps, de générer des connaissances sur les pratiques informationnelles des personnes étudiantes, enseignantes et chercheuses ainsi que des pratiques de gestion documentaire, médiation et formation des bibliothécaires par rapport à l’offre de services en lien avec l’IAGen. Elle permettra de mieux comprendre la posture professionnelle des bibliothécaires et les défis des programmes, services et politiques en bibliothèque universitaire dans la transition éco-numérique. Dans un second temps, cette étude visera à explorer collaborativement, avec des scénarios prospectifs à l’horizon 2050, de nouveaux usages et rôles découlant de l'utilisation de l'IAGen en bibliothèque universitaire.
Coordination : coopération franco-québécoise (CPCFQ)
Porteurs : Vincent Liquète, MICA et Marie Martel, Canada
Durée : 24 mois (2025-2026)
Budget : 30 000 $CAN partie canadienne et 19 500 € partie françaiseAAP conjoint entre l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ)
Savoirs territoriaux et cartographies autochtones: Partenariat de mobilisation et de diffusion des savoir traditionnels anicinabek (Québec), Atikamekw Nehirowisiwok (Québec), Teko (Guyane) et Wayapi (Guyane)
Dans le contexte actuel de crise climatique et de perdition des territoires et des savoirs autochtones, le projet Savoirs territoriaux et cartographies participatives autochtones s’engage à documenter, à valoriser et à transmettre les savoirs territoriaux autochtones. Le projet vise à répondre à la question suivante : quels sont les principes et les pratiques qui sous-tendent les savoirs territoriaux traditionnels et quel rôle la cartographie participative peut jouer dans les démarches de documentation, de valorisation et de transmission de ces savoirs ? Le projet de recherche sera mené chez deux nations autochtones, les Anicinabek (Québec, Canada) et les Kali’nas (région littorale, Guyane) – qui sont déjà mobilisées dans la transmission des savoirs, la défense de leurs droits territoriaux et la préservation de la biodiversité. Les objectifs spécifiques du projet sont de : (1) documenter et cartographier des savoirs territoriaux autochtones (toponymes, récits des lieux, caractéristiques des lieux, des ressources et des pratiques territoriales); (2) coproduire, dans un processus formatif, participatif et collaboratif avec les communautés participantes, des outils pédagogiques et des cartes des territoires ancestraux visant la transmission des savoirs territoriaux autochtones; (3) développer et consolider des partenariats de recherche internationale et des échanges inter-nations autochtones par l’organisation d’ateliers, de colloques et des activités de diffusion portant sur les savoirs territoriaux réunissant les chercheurs et partenaires autochtones du Québec et de la Guyane Française.
Porteur principal Québec : Benoit Ethier, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Chercheur principal international : Matthieu Noucher, UMR 5319 Passages
Durée : 2 ans (2025-2027)
Budget total : 50 000 $CAN
projet en partenariat avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)IUF Institut Universitaire de France

Bérénice Bonhomme (berenice.bonhomme @ u-bordeaux-montaigne.fr) a rejoint l'université Bordeaux Montaigne au laboratoire des arts ARTES en qualité de Professeur de Cinéma en 2024 .
Ses thématiques de recherche portent sur la création cinématographique, l'équipe de film et l'histoire des techniques. Sa recherche se construit autour du processus de création dans le cinéma contemporain, que ce soit le cinéma prises de vue réelles ou le cinéma d’animation. Membre Junior, son projet de recherche IUF se concentre sur un seul film, Persepolis, ce qui rend possible une certaine exhaustivité et permet d’articuler « faire avec » (technique) et « faire ensemble » (équipe). Comment, à partir d’un ouvrage autobiographique, celui de Marjane Satrapi, passe-t-on à une équipe de plus de 100 personnes, un collectif taylorisé avec une importante spécialisation des tâches ? Les micro-analyses permettront des interrogations plus approfondies, propres à faire avancer la recherche sur le cinéma d’animation et sur le processus de création.
- Projets financés par la région Nouvelle-Aquitaine